Plateformes de Recherche
Le CIMA-Q s’est donné pour mission de stimuler et de maximiser l’expertise québécoise en recherche sur la maladie d’Alzheimer. Pour y parvenir, le Consortium a mis en place des groupes d’experts et des plateformes de recherche dédiées, qui se concentrent sur les objectifs suivants :
- Identifier des tests cognitifs prédictifs à la fois fiables et sensibles.
- Découvrir de nouveaux marqueurs de neuroimagerie pour améliorer la précision du diagnostic.
- Développer de nouveaux biomarqueurs et cibles thérapeutiques, ouvrant la voie à des traitements novateurs.
- Explorer les facteurs de risque et les facteurs préventifs pour mieux comprendre et prévenir la maladie.
Ces initiatives ont déjà conduit à la publication de nombreuses études scientifiques, témoignant de la richesse et de la productivité des travaux réalisés par ces groupes d’experts.
Biomarqueurs et cibles thérapeutiques
Direction: Sébastien Hébert PhD et Pierrette Gaudreau PhD, FCAHS

L’équipe du groupe Biomarqueurs et Cibles Thérapeutiques met à disposition un vaste éventail d’échantillons biologiques accessibles aux chercheurs sur demande. Dans le cadre du projet CIMA-Q, ces échantillons sont collectés à différents moments, offrant ainsi une précieuse dimension longitudinale.
Grâce à cette ressource unique, les chercheurs peuvent innover dans leurs travaux, favorisant la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques et/ou de mécanismes moléculaires susceptibles de transformer les approches actuelles. L’émergence de ces nouvelles hypothèses ouvrira de nouvelles perspectives sur le développement et la compréhension de cette maladie. Pour plus de détails visiter la section DONNÉES
Marqueurs cognitifs et neuropsychiatriques
Direction: Benjamin Boller PhD
Des études récentes indiquent que la maladie d’Alzheimer commence à se développer entre 5 et 15 ans avant l’apparition des troubles de la mémoire, du langage et du jugement. Diagnostiquer la maladie le plus tôt possible représente un défi majeur, car une fois que les troubles cognitifs deviennent trop avancés, l’efficacité des traitements diminue considérablement.
Le groupe « Cognition » s’est fixé pour objectif de concevoir une batterie de tests et de questionnaires capables de prédire, chez une personne présentant peu ou pas de symptômes, la probabilité qu’elle développe la maladie d’Alzheimer dans les années suivantes.
Pour atteindre cet objectif, les chercheurs du groupe utiliseront des outils permettant d’évaluer, entre autres :
- Les fonctions cognitives, telles que la mémoire et le langage.
- La perception subjective d’un déclin cognitif.
- Certains symptômes psychiatriques, notamment la dépression et l’anxiété.
Ces efforts visent à identifier les signes précurseurs de la maladie, ouvrant ainsi la voie à des interventions plus précoces et potentiellement plus efficaces.
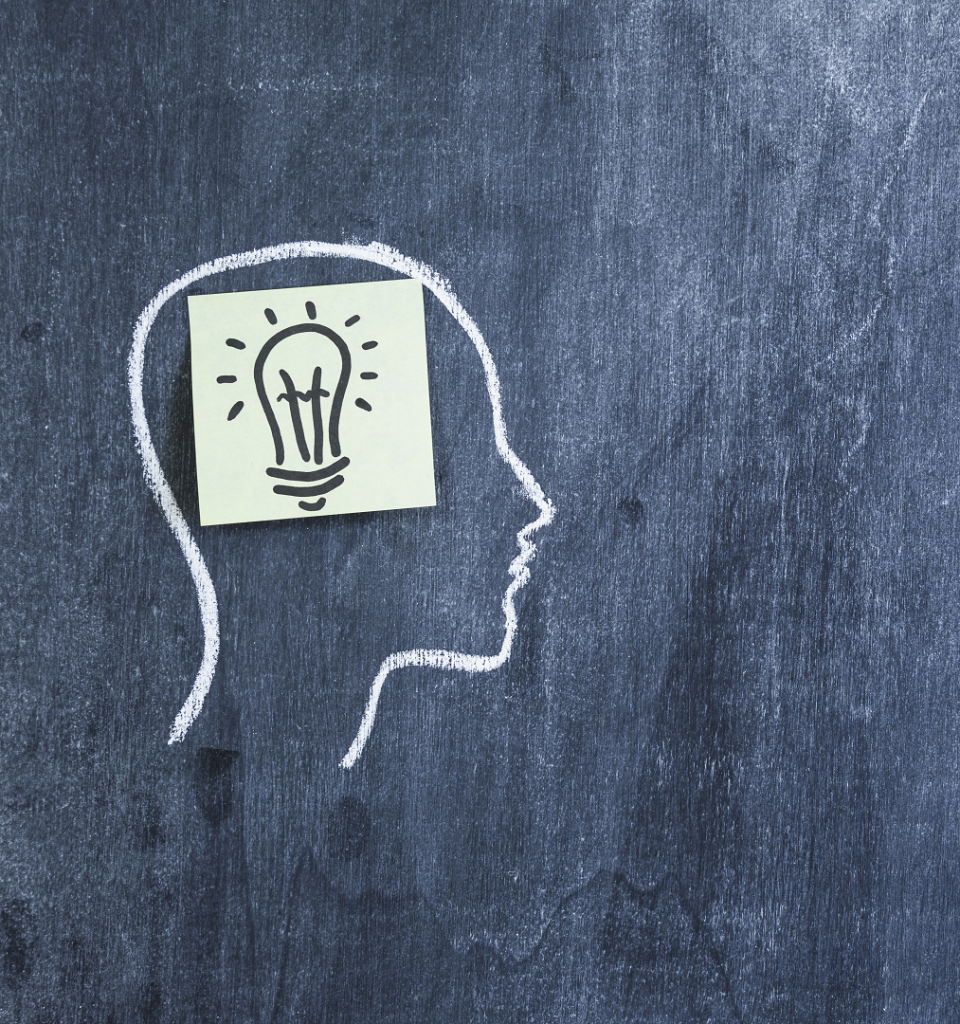
Neuro-imagerie
Direction: Mahsa Dadar PhD

La neuro-imagerie est une technique bien établie et reconnue pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer et pour évaluer le pronostic chez les personnes présentant des troubles cognitifs légers. Dans le cadre de ses travaux, le CIMA-Q veut explorer l’utilité de la neuroimagerie pour détecter des signes encore plus précoces de la maladie ou identifier des facteurs de risque associés chez les individus présentant des plaintes cognitives subjectives, souvent considérées comme les premières manifestations de la démence.
Pour répondre à ces objectifs, le Consortium a mis en place une plateforme de neuroimagerie regroupant :
- Sept sites dédiés à l’imagerie cérébrale par résonance magnétique (IRM).
- Quatre sites équipés pour mesurer le métabolisme cérébral grâce à la tomographie par émission de positons (TEP).
Les principaux centres impliqués incluent :
- Le Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
- Le Montreal Neurological Institute
- Le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
- IRM Québec
Objectifs principaux de la plateforme de neuroimagerie
- Harmonisation des acquisitions IRM et TEP
- I. Développer et valider des protocoles harmonisés.
- II. Mettre en place un contrôle continu de la qualité sur chaque site en utilisant des fantômes géométriques et humains uniques pour standardiser les données.
- Acquisition d’images cérébrales
- I. Collecter des données IRM de façon longitudinale chez le plus de participants et particulièrement chez les participants des groupes TSC et TCL.
- II. Réaliser des acquisitions TEP avec fluoro-désoxyglucose (FDG), afin de mesurer le métabolisme cérébral.
Vers des avancées diagnostiques
L’objectif ultime est de fournir aux chercheurs des données d’imagerie de haute qualité pour mener des analyses multimodales. En combinant ces données d’imagerie avec des marqueurs neuropsychologiques et biochimiques, les chercheurs espèrent développer des outils performants pour le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer, à un stade où les interventions sont les plus susceptibles d’être efficaces.
- Les fonctions cognitives, telles que la mémoire et le langage.
- La perception subjective d’un déclin cognitif.
- Certains symptômes psychiatriques, notamment la dépression et l’anxiété.
Ces efforts visent à identifier les signes précurseurs de la maladie, ouvrant ainsi la voie à des interventions plus précoces et potentiellement plus efficaces.
Facteurs de risques et de protection
Direction: Pierrette Gaudreau PhD, FCAHS
Comprendre les facteurs de risque et de protection dans la maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer (MA) est désormais reconnue comme résultant d’un déséquilibre entre l’accumulation de facteurs de risque et la capacité du cerveau à se régénérer et à se réparer. Si l’âge reste le principal facteur prédictif, de nombreux autres éléments, à la fois aggravants et protecteurs, jouent un rôle dans l’apparition et la progression de la maladie.
Les facteurs aggravants : comorbidités et déclin cognitif
Certaines comorbidités ont été étroitement associées à un déclin cognitif accéléré et à une augmentation du risque de démence, notamment :

- Le diabète de type 2
- L’hypercholestérolémie
- L’hypertension artérielle
- Les AVC ou mini-AVC
- Les affections inflammatoires chroniques
- Les épisodes de dépression clinique
Ces conditions semblent exacerber les mécanismes biologiques sous-jacents de la maladie d’Alzheimer, contribuant à la détérioration cognitive et à la progression des symptômes.
Les facteurs protecteurs : l’importance des habitudes de vie
En parallèle, un nombre croissant d’études souligne que certaines habitudes de vie saines peuvent avoir un effet protecteur sur la santé cérébrale, retardant ou même prévenant l’apparition de la maladie. Parmi les facteurs de protection identifiés, on trouve :
- L’activité physique régulière, qui améliore la circulation sanguine et la plasticité cérébrale
- Une alimentation équilibrée, notamment de type méditerranéen, riche en fruits, légumes, poissons et huiles saines
- L’engagement social, qui stimule les interactions et réduit l’isolement
- L’éducation et l’apprentissage continu, qui renforcent la réserve cognitive
- La stimulation cognitive, par des activités intellectuelles telles que la lecture, les jeux de réflexion ou l’apprentissage de nouvelles compétences
Une approche proactive pour préserver la santé cérébrale
Ces découvertes mettent en lumière l’importance d’adopter une approche proactive pour préserver la santé du cerveau. En agissant sur ces facteurs modifiables, il est possible non seulement de ralentir le déclin cognitif, mais également d’améliorer la qualité de vie des personnes à risque de développer la maladie d’Alzheimer
Cohorte clinique et populationnelle / évaluation clinique complète
Direction: Marie-Jeanne Kergoat MD, FRCPC

Le projet CIMA-Q repose sur une étude longitudinale, menée sur plusieurs années, impliquant environ 421 participants âgés de 65 ans et plus, répartis selon différents stades d’évolution des troubles cognitifs. Ces participants incluent :
- Des personnes cognitivement saines
- Des individus présentant des troubles subjectifs de la cognition
- Des personnes atteintes de troubles cognitifs légers
- Des patients diagnostiqués avec une démence de type Alzheimer.
Recrutement des participants
Les participants sont recrutés à partir de différentes sources :
- La communauté
- Les cliniques de la mémoire à travers le Québec
- La cohorte NuAge, un regroupement de participants initialement recrutés en 2004-2005, bien caractérisés et sans troubles cognitifs au moment de leur inclusion, qui ont été suivis pendant plusieurs années.
Objectifs et collecte de données
Lors de l’évaluation clinique, des informations provenant de plusieurs domaines de la santé sont recueillies, notamment :
- Informations socio-démographiques
- Évaluation médicale complète
- Neuropsychologie, neuropsychiatrie
- Auto-perception de la santé
- Bilan sanguin
Ces données permettront d’identifier des biomarqueurs précoces et pertinents pour la détection et la compréhension de la maladie d’Alzheimer.
La contribution des participants
Les participants constituent l’épine dorsale de l’initiative CIMA-Q. Leur implication est essentielle pour faire progresser la recherche sur la mémoire et les troubles cognitifs. En participant à cette étude, ils contribuent directement à l’avancement des connaissances sur la maladie d’Alzheimer et jouent un rôle crucial dans l’amélioration des soins et des traitements pour les générations futures, au Québec et à travers le monde.
Banque de cerveaux
Collaborateur: Naguib Meshawar PhD
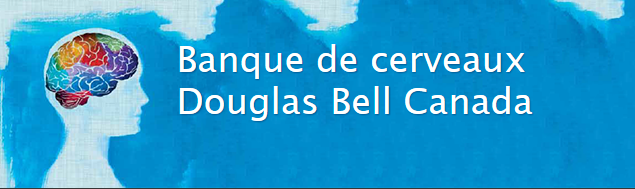
L’étude des tissus cérébraux : une clé pour comprendre les maladies du cerveau
L’analyse des tissus cérébraux joue un rôle fondamental dans la compréhension des troubles mentaux et neurologiques. En permettant aux chercheurs d’accéder à ces échantillons, il devient possible de découvrir les causes des maladies du cerveau et de développer des traitements efficaces pour des pathologies telles que la maladie d’Alzheimer.
La mission principale de la Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada est de fournir à la communauté scientifique des échantillons cérébraux de qualité supérieure, préservés dans des conditions optimales pour la recherche. Grâce à ces échantillons, les chercheurs peuvent approfondir leurs connaissances et travailler à des solutions pour traiter, guérir et prévenir les troubles et maladies du cerveau.
Une ressource unique au Canada
Créée en 1980, la Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada est la plus ancienne banque de cerveaux au pays. Elle est également la seule à être pleinement opérationnelle, avec plus de 3 000 spécimens rigoureusement caractérisés. Cette précieuse ressource offre un soutien inestimable aux chercheurs dans leurs travaux sur les maladies cérébrales.
Une contribution au projet CIMA-Q
La Banque de cerveaux Douglas-Bell Canada est fière de s’associer au projet CIMA-Q, renforçant ainsi l’élan de la recherche sur la maladie d’Alzheimer au Québec. Cette collaboration permet de mettre à disposition des chercheurs des outils et des ressources uniques, contribuant directement à l’avancement des connaissances et à l’amélioration des soins pour les personnes atteintes de cette maladie.
 Sylvie Belleville (Ph. D.)
Sylvie Belleville (Ph. D.) Frédéric Calon (Ph. D.)
Frédéric Calon (Ph. D.)  Simon Duchesne (eng., Ph. D.)
Simon Duchesne (eng., Ph. D.) Pierrette Gaudreau (Ph. D.)
Pierrette Gaudreau (Ph. D.) Carol Hudon (Ph. D.)
Carol Hudon (Ph. D.) Marie-Jeanne Kergoat (M.D.)
Marie-Jeanne Kergoat (M.D.) Naguib Mechawar (Ph. D.)
Naguib Mechawar (Ph. D.)